Ici et maintenant
Documents d'artistes constitue dans les régions PACA, Bretagne, Rhône-Alpes et Aquitaine, une plateforme de référence pour les artistes et une ressource pour les professionnels. Il est ainsi possible de rester en lien avec la création hexagonale malgré l’éloignement, de suivre l’évolution des corpus au gré des mises à jour, de gommer les distances en consultant les pages et dossiers à tout moment. Cette disponibilité, qui est celle intrinsèque à internet, confond désormais le temps instantané et le temps vécu1 dotant le navigateur d’un don d’ubiquité vertigineux et d’une hypermobilité frénétique. L’ « ici et maintenant » sont ainsi « rafraîchis » à chaque connexion et chaque déplacement virtuel, relativisant la teneur du point du vue depuis l’inamovibilité de son écran d’ordinateur et le flot continuellement renouvelé de données. Dès lors, où se situe-t-on exactement ? Comment se repérer alors même que les marqueurs se troublent et se recalculent en continu. « Cette multitude d’espaces comme l’existence des non-lieux n’indiquent-elles pas l’émergence d’un « espace » autre ? Un « espace » dont la facture ou la nature ne seraient-elles pas celles des lieux et de l’espace physiques ? Quant au temps, la disparition de l’alternance des rythmes, diurnes et nocturnes, ou l’irruption de multiples dyschronies soulignées par certaines théories urbaines ne manifestent-elles pas l’apparition d’un temps autre, discontinu et non fléché qui se différencie du temps existentiel ou vécu ?2 » s’interroge Anolga Rodionoff. Dès lors, comment régir cette masse, que choisir, comment regarder cette manne artistique ?
Plutôt que d’imaginer un musée dans la généalogie de celui, imaginaire, de Malraux récemment étudié par Georges Didi-Hubermann3, imaginons un environnement, l’ambiance d’un lieu qui combinerait l’œuvre et sa documentation, son « image-perception » et son « image-souvenir » pour reprendre les concepts d’Henri Bergson4. Jusqu’à présent, les tentatives d’expositions dématérialisées, en ligne ou publiées, ont composé un corps frustrant, impuissant à substituer l’expérience de l’œuvre par autre chose qu’une procuration visuelle résiduelle. Construire un paysage ou un environnement, c’est déjà tirer parti de la nature même du sujet-médium : un point de vue composite et projeté sur un territoire cadré par la subjectivité du regardeur. Selon Jean-Louis Weissberg, « L’instantanéité n’y est pas le principe dominant, mais un des modes d’existence de la durée, tout autant que la progression, l’arrêt ou l’absence de repérage temporel. Nous ne voyageons plus dans ces paysages, ce sont eux qui voyagent grâce à nous. L’essence du parcours interactif c’est la mobilisation de l’environnement. Nous sommes devenus des aiguilleurs scénographes, réglant des vitesses de défilement, des zooms, sélectionnant des champs de vision. Le voyage acquiert une nouvelle dimension, non plus dans l’espace mais dans l’épaisseur du réel qui fait mouvement vers le spect-acteur5. »
Il est donc permis de composer son propre désir de paysage mais plutôt que de chercher un réalisme naturaliste forcément voué à l’échec, la stratégie de l’indice fonctionnant ici comme un embrayeur de sensations, de souvenirs, une fantasmatique délivrée du lien au lieu et au temps pour mieux exister dans l’ici et le maintenant d’un paysage déduit. Ainsi, c’est par bribe que se construit la navigation, parmi les corpus de différents artistes dont la documentation mise en ligne constitue autant de républiques autonomes à visiter. En piochant, au gré des connivences, des reconnaissances et des affinités, des découvertes aussi, à la faveur d’une image séduisante fonctionnant comme une invite ou une déictique, des intuitions complètement subjectives, s’élabore un drôle d’environnement avec un climat, une ambiance, des configurations plus ou moins fantasques, capables à elles seules d’ébaucher les contours d’un environnement lui-même matière à appropriation. Surtout ne pas délimiter, laisser les contours labiles, libres de se voir agréger des excroissances pour le truchement des envies du lecteur-navigateur-spationaute-regardeur-téléspectateur. Lui non plus n’a plus réellement de contours, c’est en cela que le paysage est le lieu idéal d’une tractation entre lui et moi, entre eux et lui.
Temps qu’il fait et temps qu’il est6
Culte du présentisme7 oblige, l’éternité ne constitue plus un point de repère aussi prégnant et le marqueur capricieux que constitue le terme générique de « temps » est relativisé à chaque instant. Mais même dématérialisé, notre rapport n’en reste pas moins sensible, programmés que nous sommes par les changements d’heure et de saisons.
Ainsi, une carte postale d’Olivier Millagou ne raconte pas le temps qu’il fait, elle esquisse à son revers travaillé à la pointe, un motif de palmier laissant imaginer une vue paradisiaque au-delà de son dos absent, dépourvu d’anecdotes balnéaires et climatiques (Scratch Postcards, 2012). Il n’empêche que cette missive là installe aussi sûrement une ambiance climatique, la faute au souvenir de l’exercice social et amical de la rédaction de cartes de vacances. Ainsi, même une carte virginale concentre-t-elle encore un peu le goût et le temps d’un lieu. Infusée du conceptualisme existentiel d’On Kawara, le jeu épistolaire d’I Was There (2005) témoigne de l’itinérance de l’artiste (ou de ses messagers) cultivant au passage un mode de communication archaïque à l’heure de l’internet haut débit. Comme un peu de temps cultivé comme pour assurer de sa présence au monde, Millagou fait aussi prendre des insolations à ses cartes postales aux couleurs fanées et aux vedute fatiguées. « Illuminées » d’un palmier incongru obtenu par surexposition, les cartes empilent les strates et les temps (Fade Postcard, 2007). Et l’atomium de Bruxelles ou l’Alexanderplatz à Berlin de se parer d’une atmosphère estivale aussi incongrue que sexy, un « effet Hawaï » mâtiné de solarisation, Millagou ne craignant pas les cocktails explosifs.
Johann Rivat a le même sens du carambolage visuel dans un tout autre style. S’adonnant à la peinture, il réalise des paysages sous acide comme cette vue architecturale combinée à des feuilles de philodendrons fantomatiques dans Monument #1 (2012) ou une station service envahie d’une végétation aussi luxuriante que spectrale (Monument #3, 2012). Au milieu d’une étendue aqueuse peinte « à la Doig » surgit le poteau indicateur d’un KFC (Me and the colonel, 2009) collision visuelle digne d’une recherche d’images sur Google qui finit toujours par des rencontres improbables et transgenres. Johann Rivat est un jeune de son temps qui peut autant combiner dans sa liste de référence l’écrivain libertaire Henry G. Thoreau et New Order, Félix Valloton et Ed Ruscha, Joseph Beuys et Steven Shore. Cet éclectisme là reflète parfaitement la culture de cette nouvelle génération pour qui les chronologies et les adhérences aux mouvements n’ont plus vraiment de sens. L’« ici et maintenant » déconnecte des usages autant qu’il surinforme ainsi que l’a démontré l’explosion dans les années 2000 des usages du sample et autres open-sources offertes par le net. La peinture d’aujourd’hui est le signe de ce télescopage dans le temps paradoxalement traditionnel de sa facture et celui, présent, de l’ubiquité.
Paysage à emporter
Nombreuses sont les études à rappeler antinaturalisme du paysage, cadrage culturel, vue de l’esprit apposée à un territoire. Objet du regard, surface de projection, le paysage n’existe pas en soi, il se compose en combinant l’expérience du dehors à la mémoire vive du regardeur.
Boris Chouvellon est un glaneur de paysages et de signes de paysages qu’il translate de leur milieu d’origine aux salles d’exposition. Ainsi, une coque de piscine en fibrociment, de celles qui marquent comme des totems postmodernes les zones périurbaines, est-elle reproduite, dressée comme une ruine solennelle dans une salle d’exposition ou un parc (Détournement de fonds, 2011). Chouvellon n’aime rien que les « espaces frontières », ceux qui délimitent la ville ou le rivage, circonscrivent des hiérarchies de plus en plus obsolètes. Il transporte ces marqueurs sociaux et architecturaux d’une zone à un non-lieu, celui du white-cube si déterminant malgré ses caractéristiques génériques. Dernièrement, à la faveur d’une collaboration avec une carrière de marbre italienne, Chouvellon a modélisé un étrange microcosme : une grande roue miniature (premier paradoxe) plantée sur un paysage fossile marmoréen. Drôle d’endroit pour cette rencontre, rébus visuel et ode à la déréliction rejouée sous forme de table basse (Sans titre, 2013) à l’instar d’une colonie campée sur des plaques parfaitement polies celles-ci. Le paysage s’emporte et se déporte de ses prérogatives, rejouant sans cesse la place de l’observateur, décadrant sans cesse ses attentes.
Julie Fortier emporte aussi des paysages. Elle importe ceux de son Québec natal au fil de vidéos ou de chroniques comme Mémoire durable, enregistrement photographique à partir de 2006 de la coupe-claire d’une forêt près de chez ses parents dont elle documente la repousse avec une seule prise de vue par an. Entre méthode objective et procédure sentimentale, Julie Fortier reconstruit un environnement, collant ses images sur des planches, un journal parcellaire et indiciel qui déroute les méthodes conceptuelles d’enregistrement drastique. À la régularité s’ajoute ici une perte tangible, d’informations comme de lien. Avec la même sensibilité, elle filme le démontage et la migration d’une maison de démonstration, lointaine dégénérescence du passé pionnier de son continent qui poussait au déplacement au fur et à mesure que les terres s’épuisaient. Dans son itinérance, Julie Fortier trimballe une grosse roche sur le sommet d’une petite voiture modeste. « Vous avez juste pas pu profiter de l’été, quoi » est une drôle de charade visuelle, ode drolatique au transport paysager.
On retrouve de cela chez Pierre Malphettes dans sa façon de composer des situations paysagères, des embrayeurs de lieux, entre souvenirs et projections. Qu’il touche à la vidéo, à l’installation ou la sculpture, ses œuvres nous « embarquent » souvent dans des histoires et des déambulations. Qu’il se limite à des formes indicielles (source, rocher, souche d’arbre, tas de sable, fenêtre) ou qu’il déploie une ambiance climatique ou un paysage générique. Une flaque (l’Estaque) participe d’ailleurs de cette logique récente. Elle fait partie d’une série de plusieurs sculptures en inox poli, constellées de pierres glanées au gré des promenades, comme serties au milieu d’un écrin miroitant. Si cette flaque particulière porte le nom de L’Estaque, quartier de Marseille en bord de mer et célébré par les peintres au tournant du 20e siècle (Braque et avant lui, Cézanne), il ne s’agit pas vraiment ici pour Malphettes de s’approprier une généalogie prestigieuse. C’est davantage la question du site et du non-site soulevée par l’Américain Robert Smithson, à partir de 1969, lorsqu’il déplaçait des miroirs dans le paysage et ramenait des tas de pierres dans les espaces d’exposition qui font ici référence. Une flaque participerait bien de ce glissement de terrain, depuis une situation géographique jusqu’à une transposition en sculpture, un petit bout de l’Estaque logé dans une flaque, elle-même ramenée dans un musée. Ainsi, en est-il d’ailleurs des sites des Corbières, du Crozon et du Rayole, désormais dotés eux-aussi d’une flaque à deux ou trois pierres. Dans cette translation, le facteur-temps est alors crucial, ramenant cette association énigmatique et froide de prime abord, à la poésie d’une promenade, deux expériences condensées sur cette délicate surface réfléchissante ; un petit bout de paysage, une bribe d’après-midi, une impression ténue mais diablement efficace pour transporter quiconque y plonge son regard. Aux abords de telles sculptures plus situées, se développe un caractère générique propre à Pierre Malphettes, histoire de préserver leur porosité au vécu du spectateur et d’entretenir une poésie proche de la parabole. Étonnamment, dans l’ouvrage de l’historien Simon Schama, Le paysage et la mémoire (1999), un chapitre s’intitule « Le bois, l’eau, le roc. Nouveaux paysagistes pour l’Arcadie ». L’auteur y examine toute une tradition du paysage, notamment des compositions du Lorrain et de Poussin : « Il y a toujours eu deux Arcadie : l’hirsute et la lisse, la sombre et la claire, le séjour des loisirs bucoliques, le domaine de la panique primitive ». Malphettes pourrait aussi être un Arcadien, dans toute sa dualité.
Village global
Comparaison a souvent été faite entre le net et la notion de village global apparue sous la plume de Marshall McLuhan dans The Medium is the Message en 1967. La dissolution des frontières, contours, et par conséquence territoire, n’a pas empêché l’émergence de communautés. Même dématérialisées, elles rappellent le réflexe grégaire de l’humain.
Nicolas Momein dispose des signes comme les totems d’une communauté secrète, dans un langage sculptural codé qui combine grammaire minimaliste et vocabulaire vernaculaire. Ses productions délicieusement colorées par les serviettes de toilette aux motifs surannés comme celles qu’il utilise pour ses étrange Objets naphtaline (2013) déclenchent un sentiment d’appartenance à un groupe indéfini parfaitement incongru tant les formes, elles, sont détachées de tout affect.
Plus corporel, Laurent Le Deunff développe depuis une petite dizaine d’années sa propre archéologie, vestiges d’une communauté animiste dont on retrouve des sculptures comme fossilisées empruntant à la trompe d’éléphant sa rugosité et sa forme (Nœud de trompe 1, 2012) ou à une conque sa structure érectile (Coquillage 4, 2012). La grande évolution (2012) offrait justement un bestiaire comme dans un muséum d’histoire naturel, podium blanc magnifiant morse, coques de noix ou de cacahuète, éléphanteau presque momifié, une caravane de l’étrange émouvante agrégeant temps immémoriaux et vision du futur. La dimension fabriquée des sculptures de Le Deunff transporte dans un temps préhistorique que renforcent un grizzli, un élan, un morse et un narval que le sculpteur taille dans le bois. Sur le toit du CAPC, leurs têtes fichées comme sur des étuis de bonbons PEZ monumentaux se sont faites Totems (2007), signes d’une croyance et d’un savoir-faire autour desquels se crée une communauté d’amateurs, des signes d’un pouvoir rassembleur.
Catherine Rannou a, elle, tendance à partir sur les traces des explorateurs mais ce n’est là qu’une autre question de temps. Elle colonise temporairement des lieux où elle installe ses abris expérimentaux, fruits de sa formation en architecture. « Je tente d'épuiser un lieu, de capter les éléments qui font que petit à petit un espace est habité, occupé par une personne, une famille, une communauté. » Rannou arpente, note, nomenclature et paramètre son environnement pour mieux s’y installer. De là, elle ramène des films, des données, elle continue de bâtir, remettant sans cesse en jeu le sentiment d’appartenance.
C’est un peu ce que produisent finalement les vidéos aquatiques de Marcel Dinahet, installé off-shore, à bonne distance du rivage, entre deux eaux, observateur d’une terre ferme à la dérive. Londres prend ainsi une toute autre dimension, filmée depuis les eaux opaques de la Tamise, des chantiers maritimes se font ruines rouillées, une source aux eaux cristallines déploie sa fragilité. Dinahet filme depuis un repli du territoire, une zone mouvante comme affranchie qui ouvre les yeux sur un milieu élaboré. Observés depuis les limbes du net, depuis cette quintessence du off-shore, les rivages de Marcel Dinahet s’observent comme s’ils appartenaient à un temps révolu.
« La contemporanéité est donc une singulière relation avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant ses distances […] Ceux qui coïncident trop pleinement avec l’époque, qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points, ne sont pas des contemporains parce que, pour ces raisons mêmes, il n’arrivent pas à la voir. Ils ne peuvent pas fixer le regard qu’ils portent sur elle 8. » Sur les pas de Giorgio Agamben, ces artistes prennent de la distance, accompagnent les errances de leurs spectateurs et followers, la démultiplication de leurs points de vue dans cet « ici et maintenant » qui entretient le paradoxe de son obsolescence et de sa vitalité.
Notes :
1- Les territoires saisis par le virtuel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.
2- Id. , ibid. , p.11.
3- Georges Didi-Hubermann, L’album de l’art à l’époque du « Musée imaginaire », Paris, Editions Hazan, Musée du Louvre, 2013.
4- Henri Bergson, Matière et mémoire, Paris, PUF, 1985.
5- « Sous les vagues la plage », Paysages virtuels, Paris, Dis voir, 1998, p.24.
6- J’emprunte à Anne Cauquelin cette formule trouvée dans son introduction à Fréquenter les incorporels, Contribution à une théorie de l’art contemporain, Paris, PUF, 2006.
7- François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2002.
8- Giorgio Agamben, Qu’est ce que le contemporain ?, Paris, Payot-Rivages, 2008.
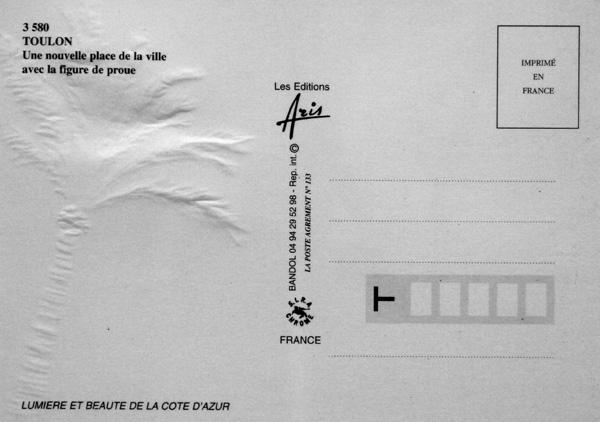
Cartes postales, 10 x 15 cm.
Courtesy SULTANA, Paris.

Impression offset sur carte postale, 10 x 15 cm. Recto et verso.

Insolation sur carte postale, 15 x 10,5 cm.
Courtesy SULTANA, Paris.

Huile et peinture à carrosserie sur toile, 114 x 146 cm

Huile et peinture à carrosserie sur toile, 146 x 114 cm

Alkyde et huile sur toile, 300 x 220 cm

Béton armé, métal, 500 x 300 x 200 cm

Tables en marbre sur roulettes, 90 x 90 x 40 cm. Maquettes dimensions variables, ciment, métal, marbre, bois

Marbres et métal, 150 x 250 x 80 cm

10 photographies couleur, sérigraphie numérique sur contreplaqué de bouleau

10 photographies couleur, sérigraphie numérique sur contreplaqué de bouleau

Photographie, tirage lambda sur aluminium, 30 x 40 cm

Inox, pierres, dimensions variables

Bois, néon, câble électrique, transformateur haute-tension, tôle larmée, inox poli-recuit, moquette,
535 x 705 x 250

Ensemble de sculptures, serviette éponge et matériaux divers, dimensions variables





Tirage numérique jet d'encre, 60 x 40 cm,
image extraite de Balises numériques 32Ko

Installation, 5 vidéos couleur, son